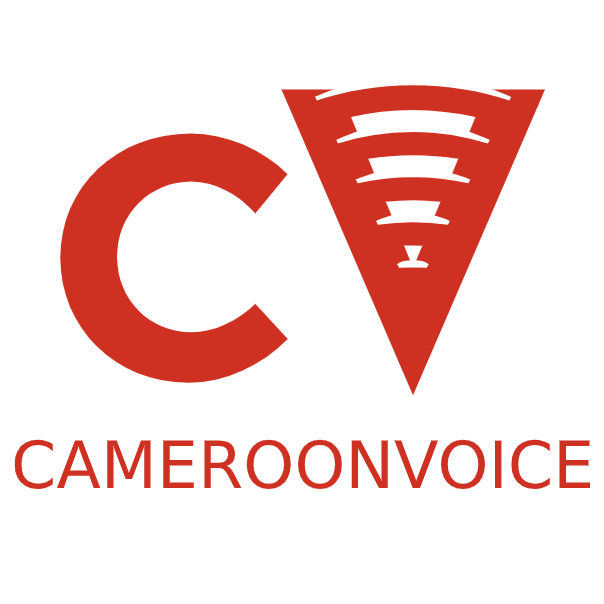Laureen Parmentier et Nonfiction
Dans son livre «Huit jours en mai: l’effondrement du Troisième Reich», l’historien Volker Ullrich retrace le double processus de dissolution et de renouveau qui a frappé le pays en 1945.

Temps de lecture: 6 min
Entre le 30 avril, date du suicide d’Adolf Hitler au moment où l’Armée rouge entre dans Berlin, et le 8 mai 1945, célébré par l’Europe comme le «Victory Day», s’écoulent huit jours pendant lesquels l’Allemagne nazie tente de continuer à exister sous l’autorité de Karl Dönitz –désigné comme successeur par Hitler lui-même dans son «testament politique». Mais l’après-guerre se dessine déjà.
Les Allemands ont alors l’impression de vivre dans une sorte de no man’s time, «un hiatus entre le “plus jamais” et le “pas encore”». C’est précisément cette confusion, ce double processus de dissolution et de renouveau que l’historien et journaliste Volker Ullrich se propose de retracer dans son livre, Huit jours en mai: l’effondrement du Troisième Reich, en prenant appui majoritairement sur des sources contemporaines et privées comme des carnets intimes, des lettres, des souvenirs et surtout des journaux de bord.
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article!
L’historien aborde ici de nombreux thèmes, dont certains classiques comme les dernières batailles, les marches de la mort, mais aussi des sujets s’inscrivant dans une historiographie renouvelée par des travaux sur le genre et l’agency –la capacité d’action des individus dans une situation donnée.
«Suicidés, par perte du sens de la vie»
Volker Ullrich s’intéresse à la vague de suicides collectifs qui a touché les Allemands à la fin de la guerre et cherche dans les sources de quoi éclairer ce phénomène. Il cite ainsi le journal de bord d’une institutrice de Demmin (Poméranie occidentale), qui écrit, en date du 1er mai 1945: «Suicidés, par perte du sens de la vie».
Entre 700 et 1.000 personnes, sur les 15.000 habitants que compte la ville, se sont en effet donnés la mort en ce début du mois de mai et, selon elle, cette «épidémie de suicides» est moins due à la peur de l’Armée rouge et de la vengeance des vainqueurs qu’à la perspective de la vie sans Adolf Hitler et ses promesses d’une vie meilleure. Face à l’incapacité d’imaginer un avenir pour eux-mêmes et leur famille en dehors du national-socialisme, le suicide leur est apparu comme la seule solution.
Lire la suite de l’article sur Slate